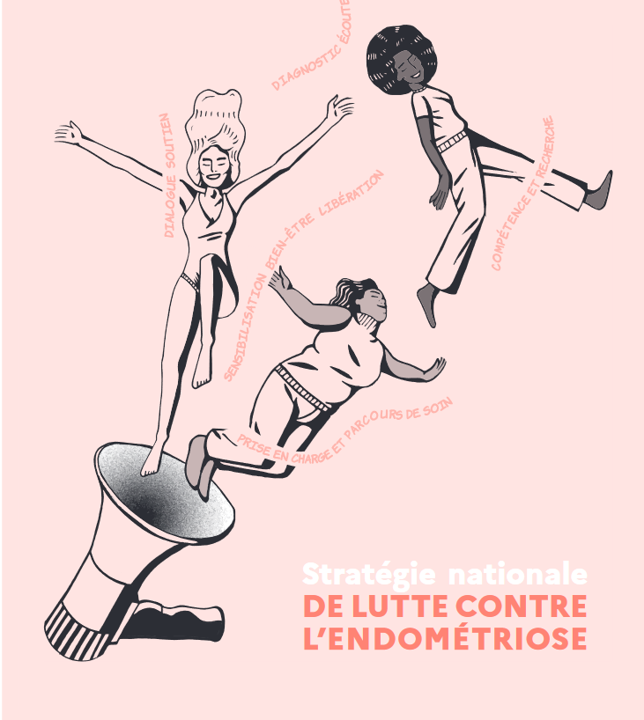La santé environnementale étant de plus en plus présente au cœur des problématiques de santé, les maternités cherchant à se tourner vers des pratiques de soins intégrant cette thématique sont de plus en plus nombreuses.
Ainsi, une dynamique écoresponsable a été initiée au sein de plusieurs maternités de l’APHP, qui s’inscrit désormais dans un programme plus large engagé par l’ARS Île-de-France.
Ce programme : « Ecomaternité », au bénéfice des femmes enceintes, des nourrissons et des professionnels a pour but de « faire évoluer les organisations et les pratiques des acteurs du parcours de périnatalité vers la prise en compte des enjeux de santé environnementale et d’éco-responsabilité ».
Retrouvez le programme détaillé en cliquant sur ce lien : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ecomaternite-lars-ile-de-france-met-en-place-un-programme-territorial-de-maternites-ecoresponsables
Certaines maternités ont déjà mis en place différentes actions, parmi lesquelles on peut citer : le remplacement du plastique au profit du verre ou de la porcelaine dans les contenants alimentaires, ou le développement d’ateliers à destination des futurs et jeunes parents. La formation des soignants en santé environnementale fait également partie de ces actions, et des formations FEES ont ainsi été organisées pour les professionnels de santé de l’APHP.
Exemples d’actions mises en place à la maternité de Trousseau sur ce lien : https://www.facebook.com/watch/?v=493565538916338
La maternité du CHU de Clermont Ferrand, a quant à elle été en fin d’année dernière, la première maternité de type 3 à obtenir le label THQSE, ce qui fait d’elle une maternité labellisée éco-responsable. Le label THQSE : Très Haute Qualité Sociale et Environnementale est un label de qualité qui garantit un degré d’engagement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social.
Pour obtenir ce label, plusieurs changements ont été opérés à différents niveaux : bio-nettoyage aux microfibres, à l’eau ou à la vapeur par exemple. Une chambre pédagogique à destination des futurs parents a également été créée, afin d’aborder de façon concrète les différents conseils en matière de santé environnementale. Tout comme pour les maternités de l’Île-de-France, différentes actions de formations des professionnels ont été entreprises, et 2 formations FEES ont donc été programmées au cours de l’année 2022 pour les professionnels de la maternité.
Pour plus de précisions concernant cette labellisation, cliquez sur ce lien : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/la-maternite-du-chu-de-clermont-ferrand-decroche-le-label-ecoresponsable-2403589.html