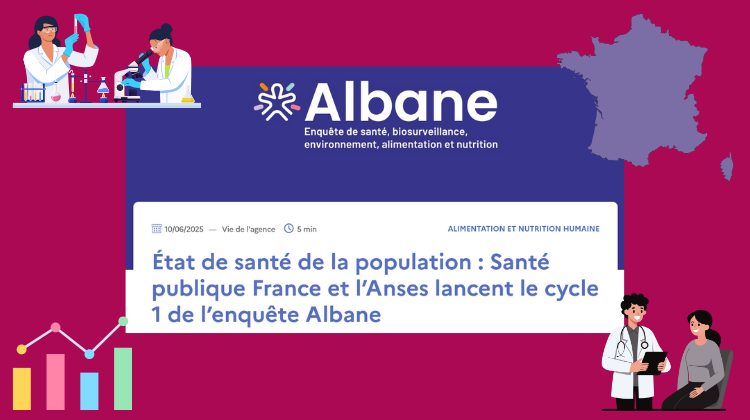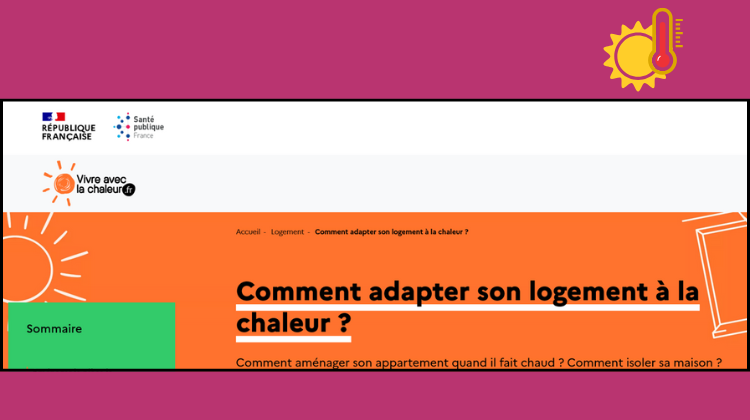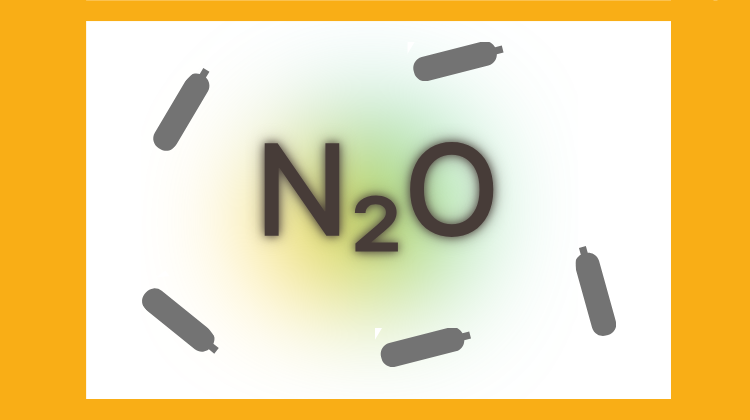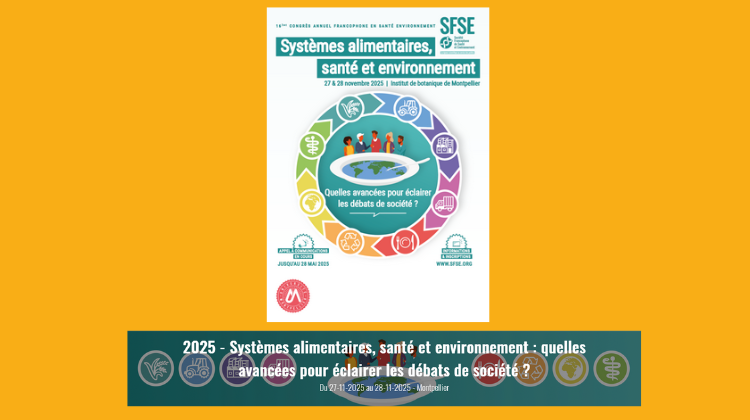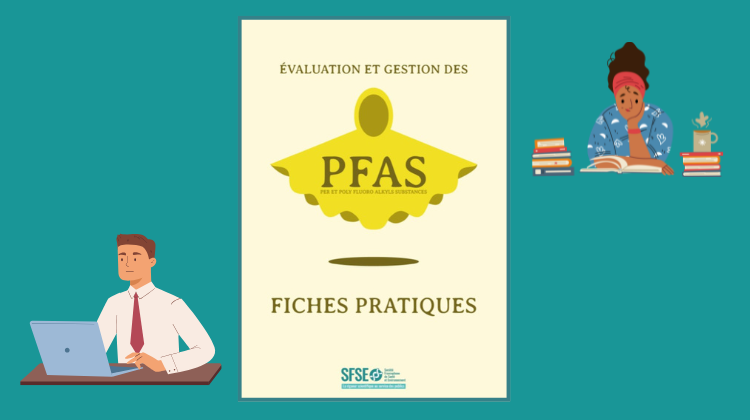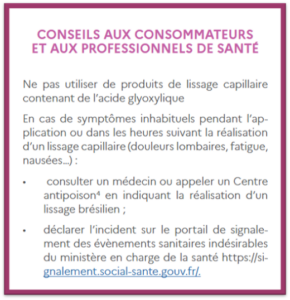La Cohorte MARIANNE est un projet de recherche national piloté par un consortium scientifique et le CHU de Montpellier.
Soutenu dans le cadre de la Stratégie Nationale Gouvernementale des TND (2023-2027), ce programme étudie comment l’environnement et les gènes influencent mutuellement la survenue et la sévérité des troubles du neuro-développement chez l’enfant.
MARIANNE prévoit d’inclure dans son étude des familles résidant sur le territoire métropolitain : chacune composée du père, de la mère enceinte (tous deux majeurs), et du futur bébé.
Cette participation des familles étant d’une importance cruciale, des supports de communication sont disponibles pour les professionnels de santé, afin de mieux comprendre et présenter la cohorte aux familles:
- une affiche (adaptée aux formats A3 et A4), idéale pour être apposée dans les salles d’attente, les lieux de passage ou encore les bureaux des professionnels de santé; où elle peut être vue par les familles.
Elle comporte les contacts et liens utiles pour permettre aux familles qui le souhaitent d’en savoir plus sur l’étude MARIANNE et de prendre contact avec l’équipe.

- un guide pour les professionnels de santé, sous la forme d’un livret de 8 pages. Conçu comme un outil permettant d’accéder rapidement aux grandes lignes directrices de l’étude MARIANNE, il comprend également un modèle d’échange type entre un professionnel de santé et une famille, présenté sous la forme d’une bande dessinée. Cet outil a été pensé pour aider les professionnels de santé à disposer des bons éléments de langage afin d’aborder le sujet de la Cohorte MARIANNE de manière fluide et efficace.

- un dépliant pour les familles, créé pour présenter la cohorte aux familles. Il met l’accent sur les bénéfices de la participation à l’étude pour les familles et aborde également des point techniques (périmètre de recrutement, critères d’éligibilité…), de plus il comprend tous les contacts utiles.

Il existe également un compte Instagram de la cohorte, et une campagne digitale pouvant être partagée.
Retrouvez l’ensemble de ces documents en cliquant sur le(s) lien(s) suivant(s) : https://cohorte-marianne.org/espace-professionnel-de-sante/comment-nous-aider/#patiente , https://cohorte-marianne.org/actualites-marianne/kit-communication/
Vous pouvez également trouver plus d’informations sur la cohorte en consultant son site internet : https://cohorte-marianne.org/, notamment la page dédiée aux professionnels de santé : https://cohorte-marianne.org/espace-professionnel-de-sante/une-commande-publique/