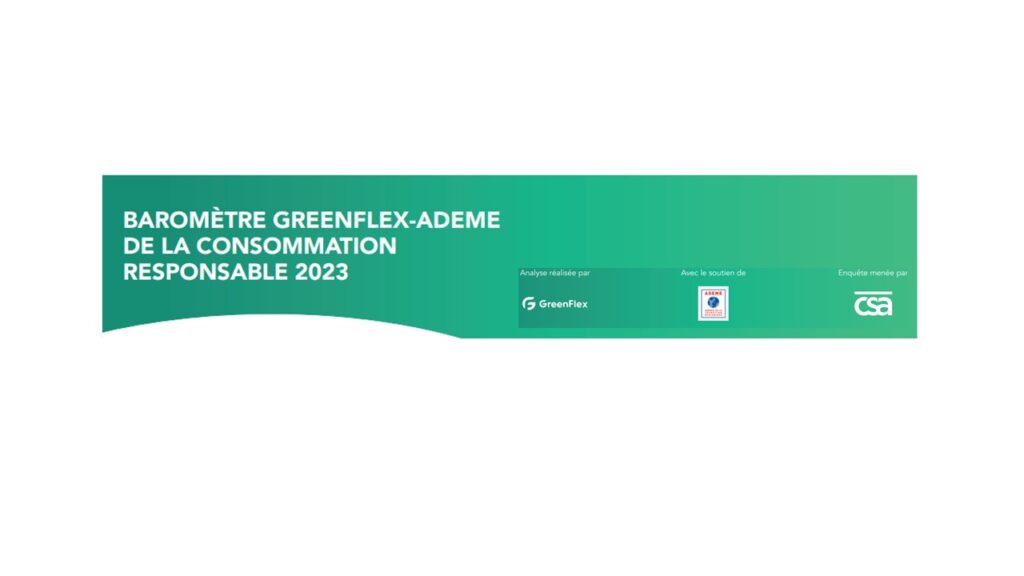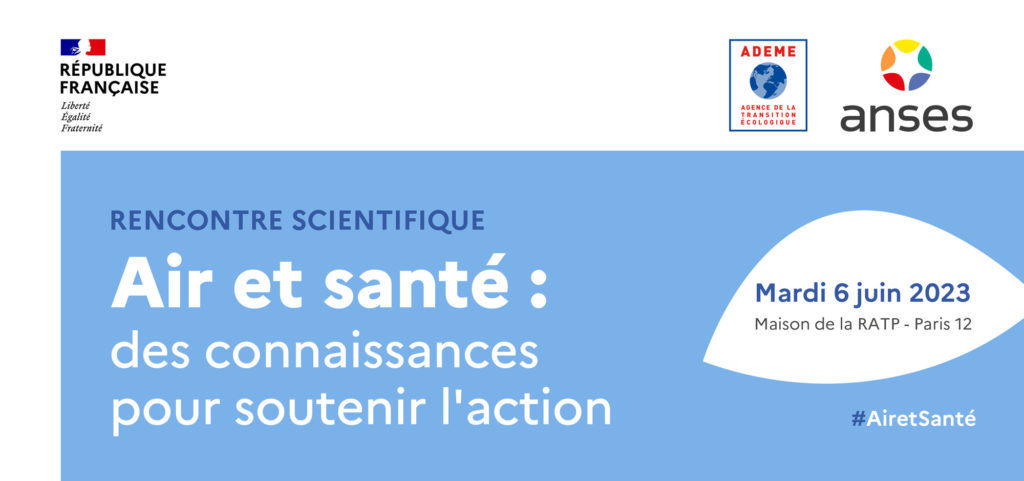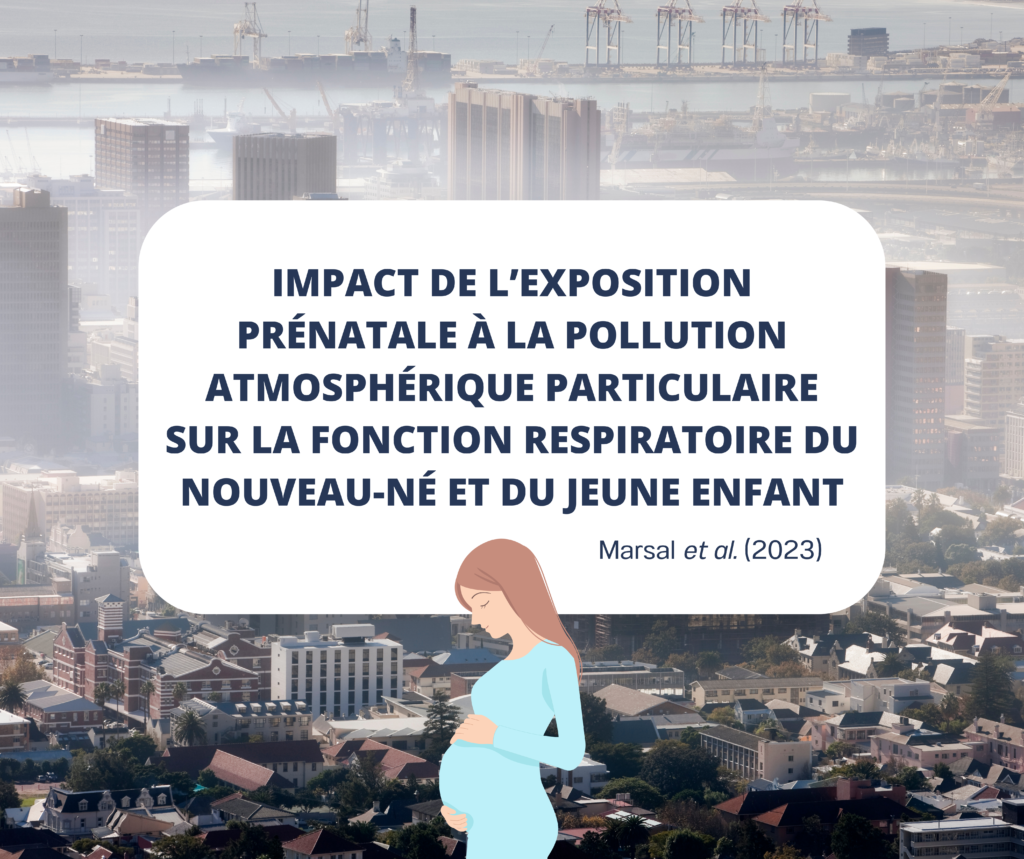Le vernis semi-permanent a l’avantage d’avoir une tenue plus longue qu’un vernis classique, entre 2 et 3 semaines. Son application nécessite donc une technologie particulière : plusieurs couches de vernis (au moins 4) et un séchage par une lampe qui combine des UV et une diode électroluminescente (LED).
Ces lampes émettent des UVA qui peuvent favoriser le vieillissement mais aussi le développement de cancers de la peau. Ils sont d’ailleurs classés cancérigènes avérés pour l’Homme (groupe 1) par le Centre International de Recherche sur le Cancer.
Le risque de cancer dans le cadre de l’usage des vernis à ongles semi-permanent semble lié à 3 facteurs :
- L’âge jeune de début d’utilisation de cette technologie (en moyenne 20 ans) ;
- La fréquence rapprochée des expositions (moyenne de 5 à 6 fois par an, voire plus avec le développement des lampes à domicile) ;
- L’exposition pendant plusieurs années.
Dans son article d’avril 2023 : l’Académie recommande « d’appliquer une crème solaire avec une protection UVA indiquée, environ 20 minutes avant l’exposition des mains aux lampes UV / LED » et d’informer le grand public et les professionnels sur les risques liés à une application continue des vernis semi-permanents dans l’année, en particulier chez les personnes de phototype clair.
Retrouvez l’article de l’Académie nationale de Médecine en suivant ce lien : https://www.academie-medecine.fr/des-ongles-brillants-mais-pas-sans-risque/
Rappelons qu’en 2017, l’ANSES avait effectué une expertise sur les risques professionnels liés aux produits utilisés dans les activités de soins et de décoration de l’ongle (pour les professionnels du soin et de la décoration de l’ongle comme les prothésistes ongulaires et les esthéticiennes). Près de 700 substances avaient été identifiées dans la composition des produits utilisés ou dans les atmosphères de travail, dont 60 qui figurent dans une classe de danger la plus élevée (en cause : leur classification CMR, sensibilisant et / ou inscrits sur une liste de perturbateurs endocriniens potentiels).
L’article de l’ANSES concernant cette expertise est disponible en cliquant sur ce lien : https://www.anses.fr/fr/content/professionnels-du-soin-et-de-la-d%C3%A9coration-de-l%E2%80%99ongle-exposition-%C3%A0-de-nombreuses-substances
Devant la multitude des substances entrant dans la composition des vernis (sous quelque forme que ce soit), le projet FEES recommande d’éviter l’application chez la femme enceinte.
Article publié en octobre 2023