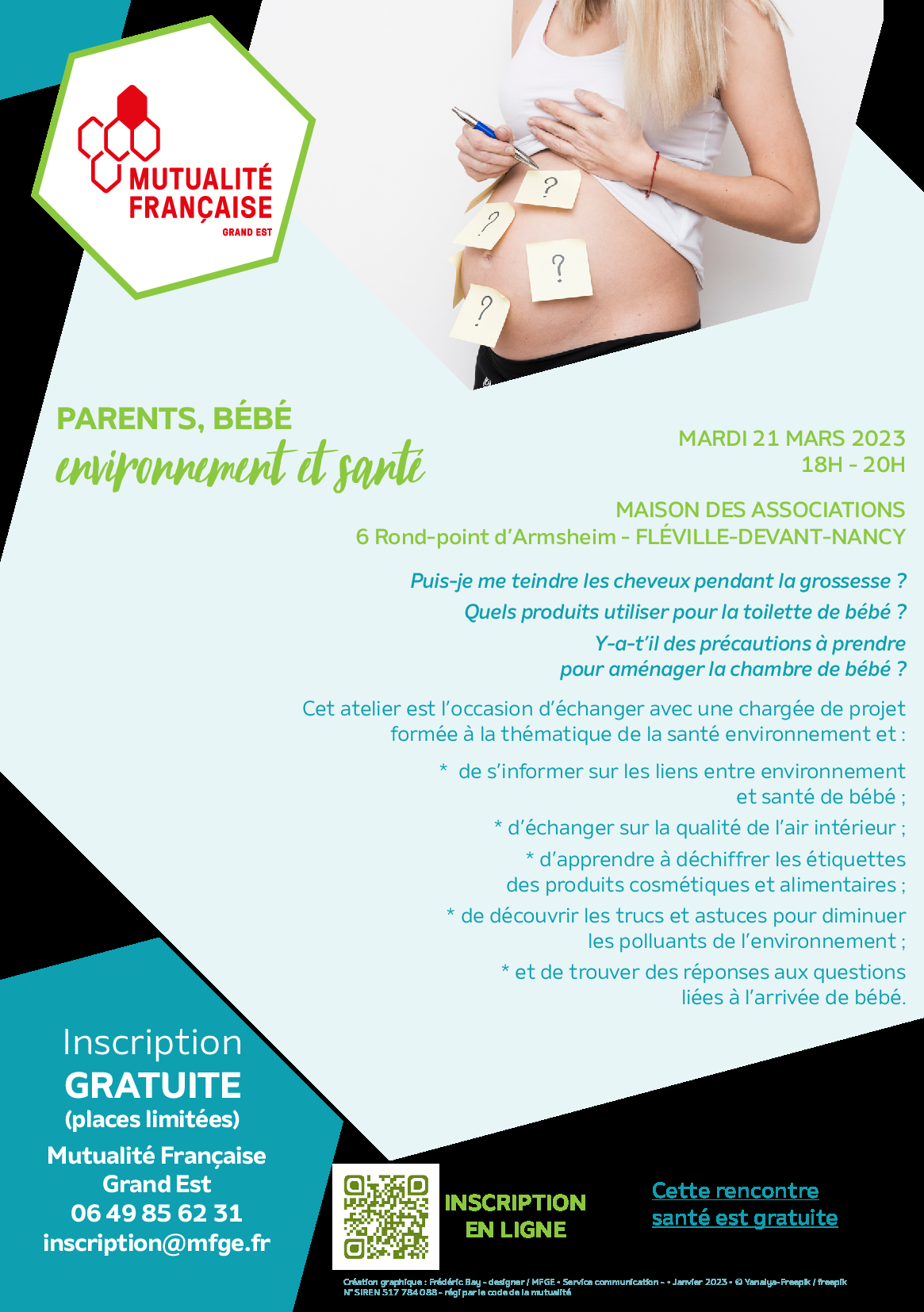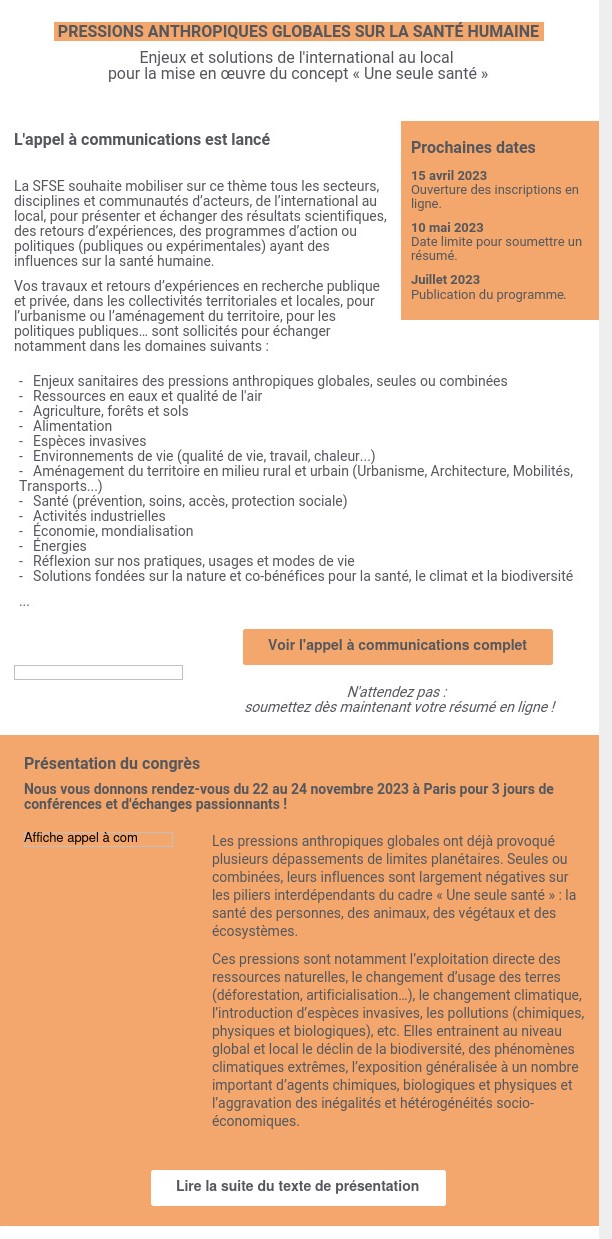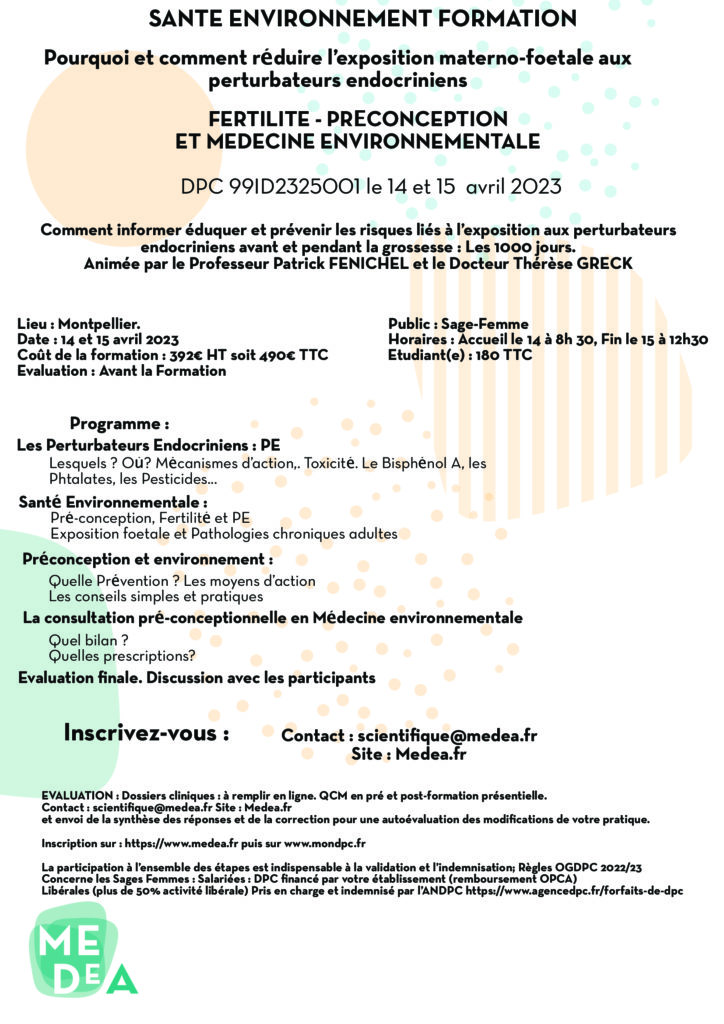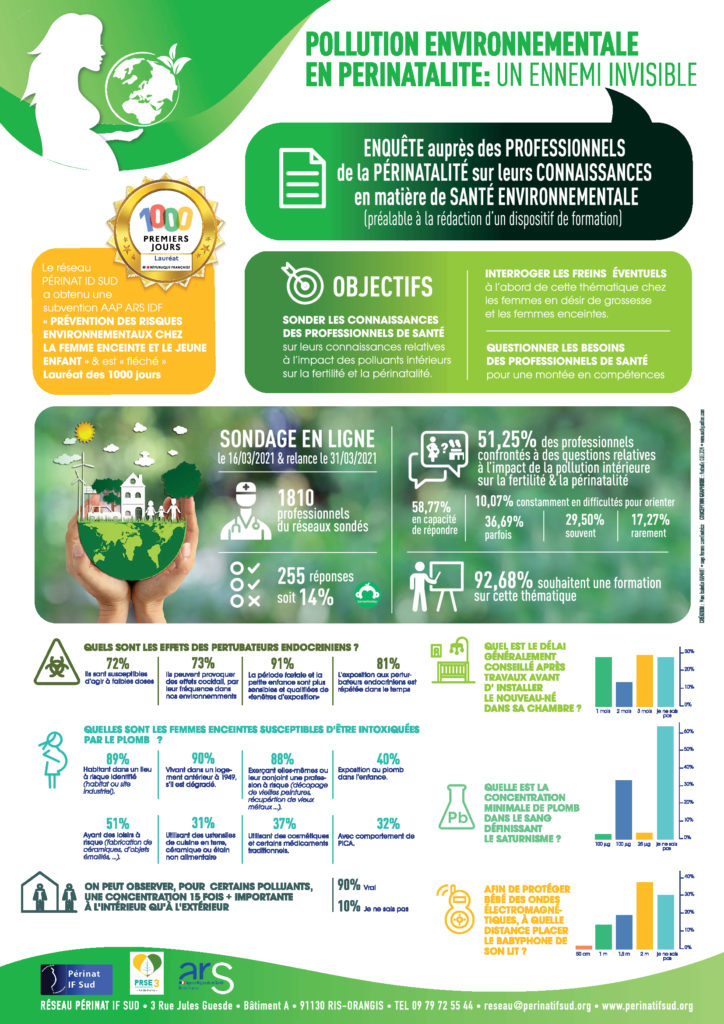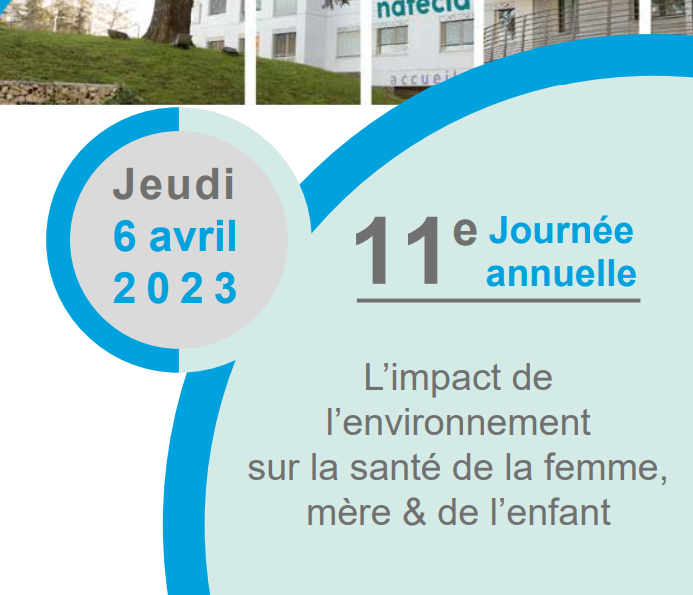Le terme de « papier cuisson » est un terme global désignant un ensemble de papiers alimentaires destinés à la cuisson et/ou à la conservation des aliments.
Comme leur nom l’indique, ils sont faits à partir de papier, mais peuvent également avoir subi différents traitement et/ou être enduits d’un revêtement leur conférant certaines propriétés (anti adhésives par exemple).
Le plus connu est peut-être le papier sulfurisé, c’est un papier traité de manière à être imperméable et à résister aux hautes températures. Il est utilisé en emballage, pour le conditionnement de corps gras, et en pâtisserie. Il peut se vendre en rouleau pour usage domestique et c’est aussi un accessoire pour l’emballage (notamment de pâtes à tarte prêtes à l’emploi dont il facilite le déroulage, la cuisson, et enfin le démoulage).
Ce type de papier est obtenu par trempage dans l’acide sulfurique. L’action de l’acide est immédiate et provoque la casse des fibres longues, qui restent alors plaquées sur le papier et assurent ainsi son imperméabilité. Le papier est ensuite immédiatement rincé à l’eau, puis séché. Recouvert ensuite d’un enduit de silicone, un film traité pour résister aux aliments gras, à l’air et à l’eau, le papier sulfurisé devient totalement imperméable.
De manière générale, dès lors qu’il est indiqué : « anti adhésif », « anti adhérent » ou « pas besoin de graisser », c’est que le papier est revêtu d’une couche lui apportant des propriétés anti adhésives. Cette couche est la plupart du temps composée de silicone (cf ci-dessous), mais la composition exacte de ces surfaces anti adhésives n’est pas toujours indiquée.
Concernant l’ensemble des papiers cuissons, on retiendra quelques conseils :
- Privilégier les papiers non blanchis, n’ayant pas subi de traitement au chlore,
- Préférer les papiers sans revêtement anti adhésif (en général dans ce cas il est indiqué d’utiliser une petite quantité d’huile ou de beurre pour graisser le papier),
- Respecter les consignes d’utilisation, et notamment les températures maximales de cuisson.
En ce qui concerne les feuilles (ou tapis) de cuisson réutilisables, elles se sont généralisées ces dernières années, et s’inscrivent dans une tendance de réduction des déchets.
En effet, elles sont intéressantes de ce point de vue, mais des questions se posent quant à leur composition. Bien que la composition précise ne soit pas toujours disponible, le revêtement de ces ustensiles est bien souvent en silicone (tout comme pour le papier cuisson). Or des données de différents tests et études révèlent que ce matériau n’est pas toujours inerte et que des composants peuvent migrer vers les aliments lors de la cuisson.
Par précaution, on préférera donc les réserver à des utilisations plutôt ponctuelles (notamment lorsqu’il n’y a pas d’alternative possible) et éviter des trop fortes températures de cuisson. Les mêmes conseils s’appliquent aux papiers cuissons jetables anti adhérents.
Lorsque c’est possible, à la place du papier ou d’un tapis de cuisson, l’idéal est donc d’utiliser un plat en verre et de le chemiser avec un peu de graisse et de farine.
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_sulfuris%C3%A9
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35569599/
Mis en ligne en mars 2023