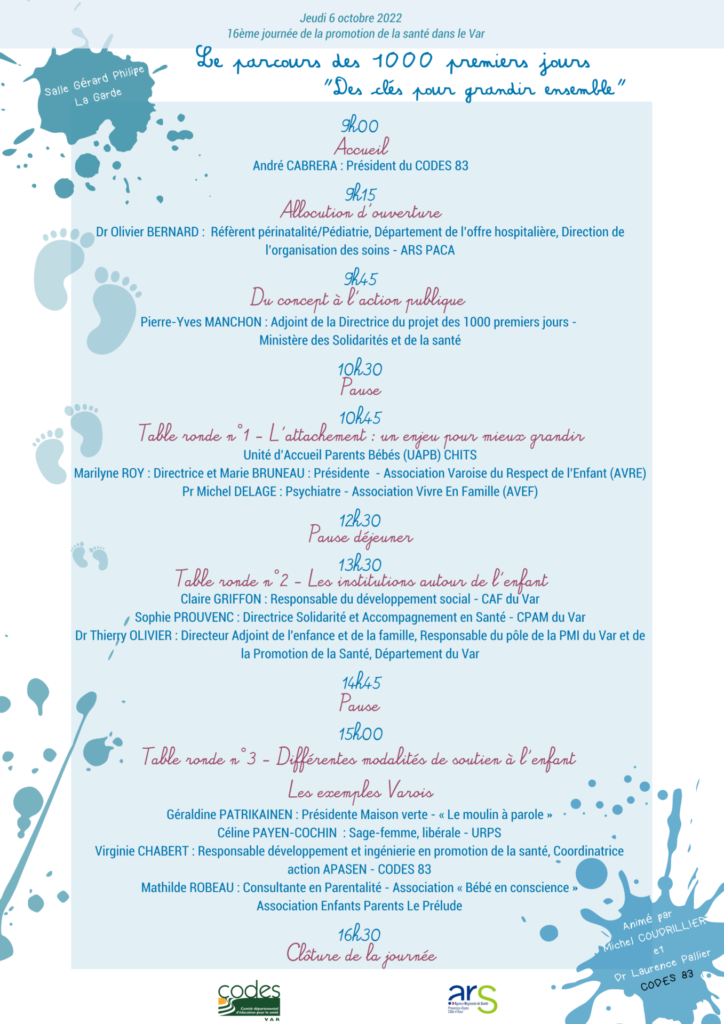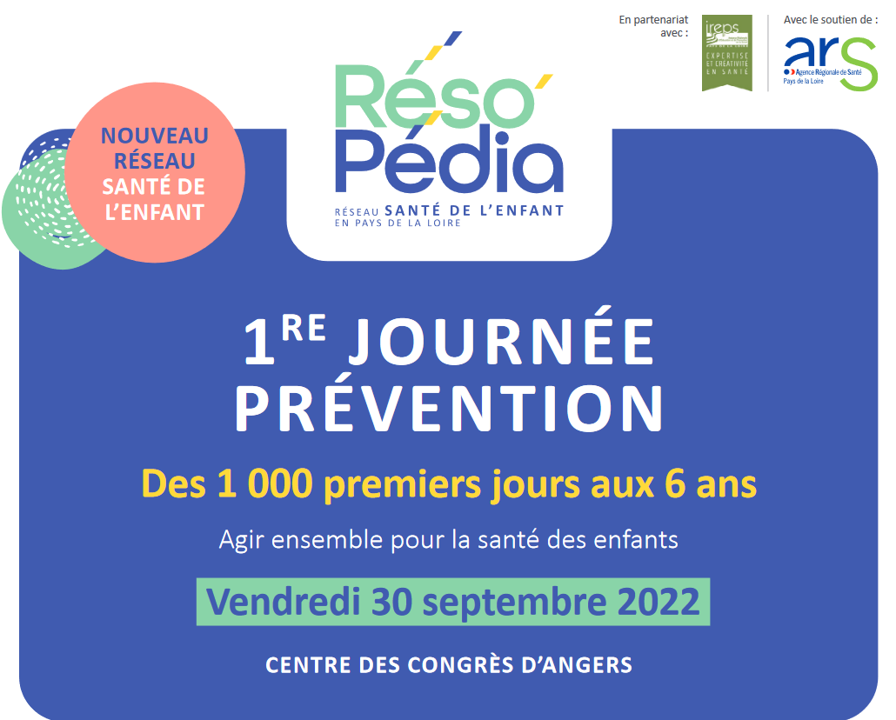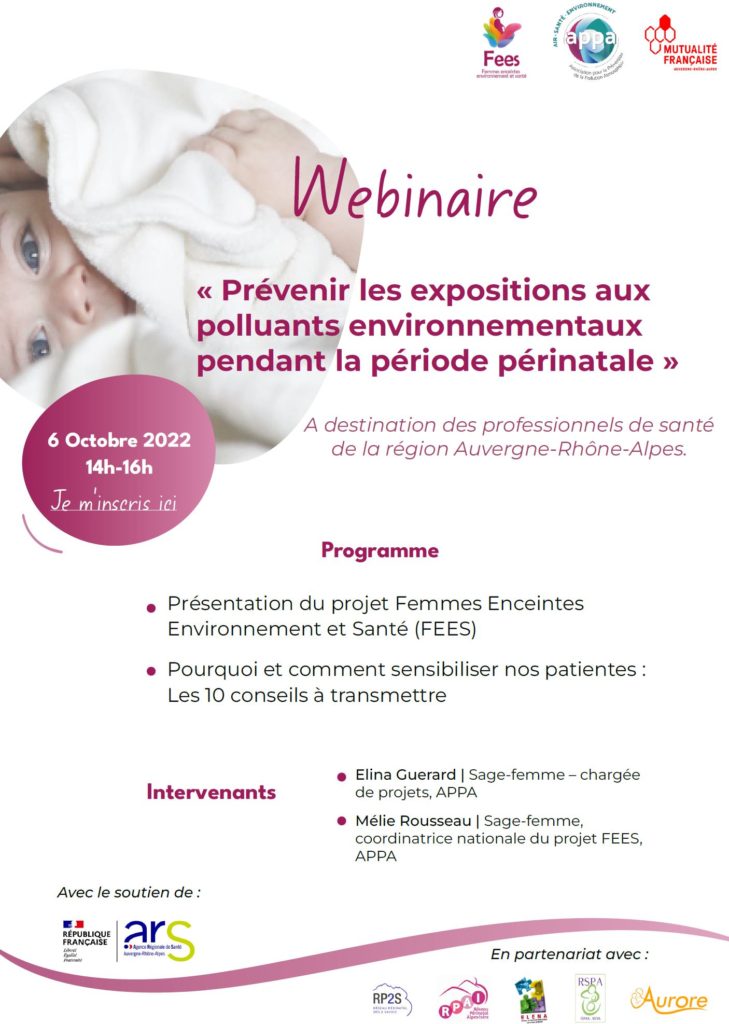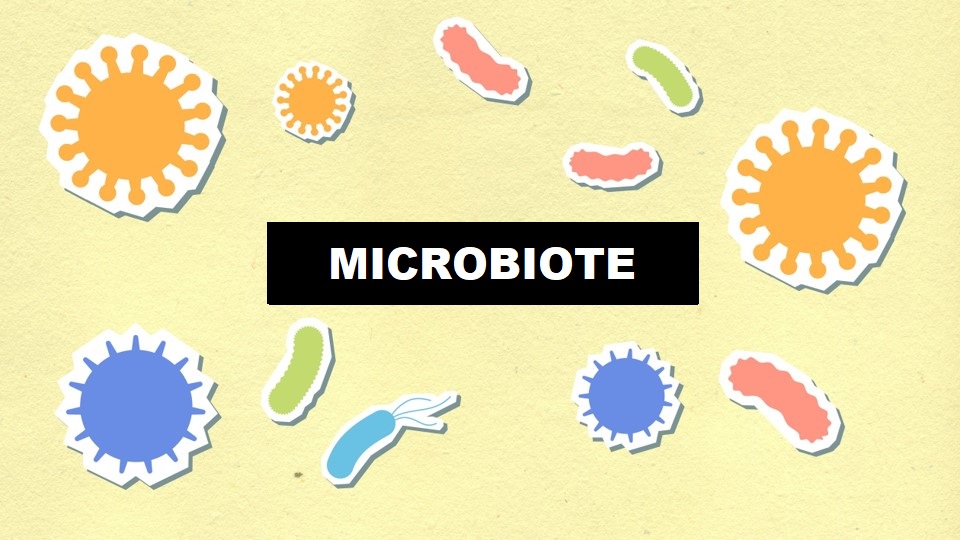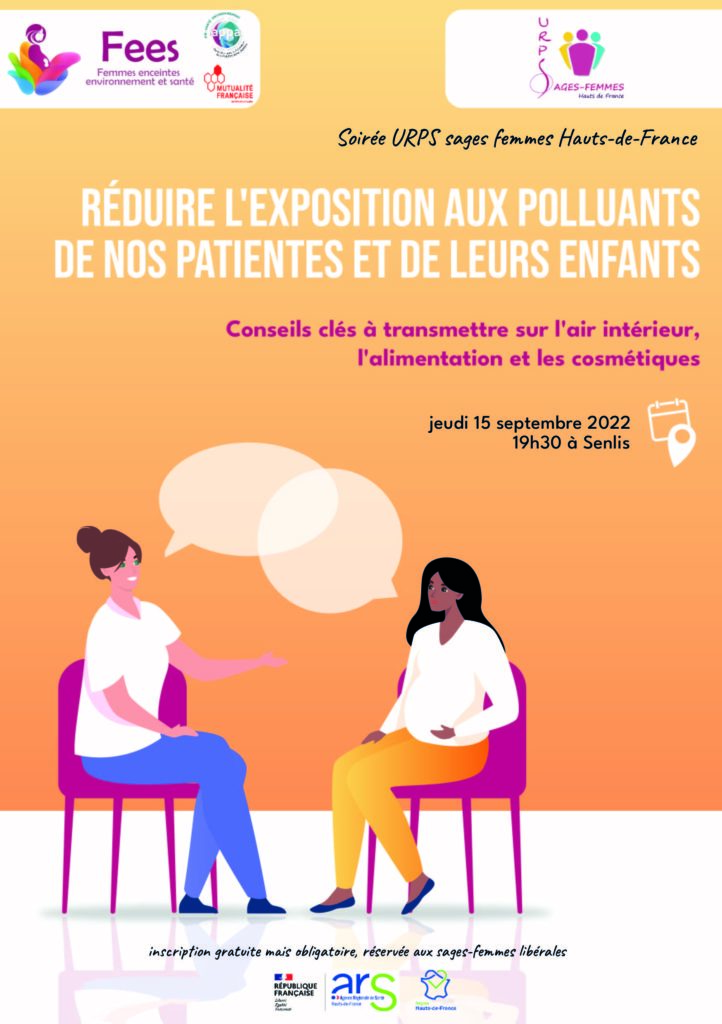Depuis plusieurs années, les nitrates et les nitrites sont sujets à de nombreuses controverses quant à leurs impacts sanitaires, et notamment concernant leur présence en tant qu’additif dans certains produits carnés tel que la charcuterie.
L’ANSES a très récemment publié un rapport d’expertise collective à ce sujet, faisons donc le point sur ses différentes conclusions.
Les nitrates et les nitrites sont des formes de l’azote.
Ils sont naturellement présents dans notre environnement, mais cette présence peut être renforcée par certaines activités humaines, telle que l’utilisation excessive d’engrais de synthèse.
Les nitrates font naturellement partie de notre alimentation. Actuellement, pour une majeure partie de la population, les apports en nitrates se répartissent ainsi :
- 62 à 69% par les végétaux (notamment les légumes feuilles, riches en nitrates)
- 20 à 25% par l’eau de boisson
- < 5% par la charcuterie (dans laquelle les nitrates sont présents en tant qu’additif)
Concernant les nitrites, ils sont majoritairement présents dans notre alimentation en tant qu’additifs dans la charcuterie, responsable de 41 à 63% de nos apports.
Une DJA (Dose Journalière Admissible = quantité de substance pouvant être ingérée quotidiennement toute la vie sans effet sanitaire) fixée par l’EFSA existe pour chacune de ces molécules. Ces DJA ont été jugées pertinentes par l’ANSES. En France, toutes sources d’expositions confondues, 99% de la population ne dépasse pas la DJA, que ce soit pour les nitrates ou les nitrites.
- Mécanismes de transformation et toxicité
Lors d’un apport en nitrates par voie orale, la majorité des nitrates ingérés (75%) est éliminé par voie urinaire, le reste est excrété dans la salive. Une très faible partie de ces nitrates salivaires peut être réduite en nitrites, qui sont eux-mêmes très instables et peuvent entrainer la formation d’autres composés, dont des composés nitrosés.
Ces dérivés présentent une toxicité, et notamment une cancérogénicité, ainsi les nitrates et nitrites ingérés dans des conditions où ils peuvent entrainer la formation de composés endogènes nitrosés ont été classés 2A (cancérogène probable) par le Centre International de Recherche sur le Cancer en 2010.
Après analyse de la littérature, le groupe de travail de l’ANSES a conclu à :
- L’existence d’une association positive entre l’expositions aux nitrates via l’eau de boisson et le risque de cancer colorectal
- L’existence d’une association positive entre l’exposition aux nitrates et/ou aux nitrites via la viande transformée et le risque de cancer colorectal
On peut noter que concernant la quantité de nitrates dans l’eau du robinet, une limite de qualité est fixée en France à 50mg/L et qu’une très grande majorité de la population reçoit une eau respectant cette limite.
- Principales conclusions et recommandations de l’ANSES
- Limiter l’apport en nitrates et nitrites via l’eau et les aliments notamment en limitant les quantités d’additifs nitrés ajoutés dans les produits carnés traités
- Limiter la charcuterie à 150g/semaine (permet de ne pas dépasser la DJA des nitrites)
- Réévaluer la pertinence de la valeur dérogatoire maximale utilisée en gestion pour les nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine (100mg/L)
- Diversifier la consommation de légumes dans le régime alimentaire total. Diverses denrées d’origine végétale peuvent présenter des concentrations élevées en nitrates. Cependant, du fait de leur richesse en fibres, vitamines et minéraux, les légumes assurent une protection à l’encontre de diverses maladies, dont le cancer.
Retrouvez le rapport de l’ANSES en suivant ce lien : https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation